La vie est précieuse. Je ne pouvais pas continuer sur la lancée de la semaine dernière sans vous soumettre cet autre lieu commun qui témoigne plus d’un idéal que d’une réalité, à dire vrai.
Les sociétés modernes, sous perfusion de la moraline occidentale, entendent nous faire croire qu’il n’y a rien de plus précieux que la vie, au point de mobiliser technicité et argent pour empêcher un candidat au suicide de sauter d’un pont ou pour interner en couveuse un grand prématuré de 25 semaines ! Dans le même temps, dirigeants et populations s’accordent néanmoins, sans aucun état d’âme, à ce que leurs intérêts économiques, financiers ou géostratégiques justifient l’élimination d’individus par dizaines de milliers à l’autre bout du monde. Comme on dit, « loin des yeux, loin du cœur ». Apparemment, la préciosité de la vie est à géométrie variable. Et c’est vrai qu’elle ne pèse pas le même poids sous toutes les latitudes, voire, plus proche de nous, dans tous les quartiers de France.
La vie d’un seul est à ce point précieuse que certains états démocratiques n’ont pas hésité une seule seconde avant d’enfermer tous les citoyens afin de protéger les plus faibles, promis pourtant à une mort à brève échéance en raison de leur grand âge et/ou de leurs graves pathologies. Ceux-là sont morts « avec » le Covid, ou effectivement « pour cause » de Covid, parce que l’infection respiratoire a gagné la course face à l’autre maladie mortelle. Le temps passant, beaucoup ont oublié l’épisode Covid de l’année 2020 et les décisions arbitraires de la Macronie – protégées par le secret-défense – lesquelles auront privilégié l’individu au collectif, et le présent immédiat de certains en obérant gravement le futur plus ou moins proche, appelé à devenir un avenir assurément moche, pour tous, ou presque.
Prétendre que la vie est précieuse atteint vite ses limites, temporelles, culturelles, sociétales et géographiques. Qui plus est, l’expression doit uniquement se comprendre pour certaines espèces, animales et mammifères le plus souvent, au détriment de toutes les autres. Car à l’exception de quelques lectures bouddhistes ou animistes, toutes les formes de vie ne sauraient se valoir ! Ce n’est donc pas tant la vie qui serait précieuse que certains êtres vivants, ceux qui répondent à des critères anthropiques forcément subjectifs et décrétés par on-ne-sait-qui et on-ne-sait-trop-pourquoi.
La vie est précieuse, mais le fait de vouloir l’anéantir, en tout ou partie, ne serait pas forcément un pêché… mortel. C’est ainsi qu’il faut comprendre, de tous temps, la justification de la plupart des massacres et, tout récemment, les travaux scientifiques destinés à débarrasser l’Homme de son entité biologique.
Si cette négation objective du concept « la vie est précieuse » ne heurte pas plus que cela la conscience humaine, c’est sans doute parce que le fond d’animalité qui réside dans notre cerveau primaire, ou reptilien, nous conduit à nous inscrire en faux avec ledit précepte. Car si la vie était communément et universellement précieuse, elle se serait arrêtée dans son évolution aux règnes des bactéries, des archées, des protides et des végétaux. En tant qu’animal supérieur, l’être humain est bien placé pour savoir que le processus vital n’en est rien fait. Bien au contraire, les animaux ont pris le pouvoir avant que l’Homo sapiens ne devienne Prométhéen !
Dire que la vie est précieuse n’a pas de sens. Sauf à la comparer aux gemmes selon le seul critère de la rareté, les unes dans leur répartition sur Terre, et l’autre dans sa spécificité apparente au sein de l’Univers connu.
En fait, à ce qu’en dit la science actuelle, la vie n’est qu’un processus biologique amené à se perpétuer à travers les âges géologiques, sous différentes formes et en fonction des facteurs qui lui sont extérieurs. A ce titre, elle obéit à des lois naturelles que les sociétés modernes entendent désormais contrarier, faisant courir à l’humanité d’abord, et à l’ensemble du Vivant biologique ensuite, les périls d’un danger mortifère.
Observer la Nature est le seul enseignement qui soit véritablement digne d’intérêt. Permettez que je vous soumette ici l’une de mes récentes observations.
Abandonnée par des héritiers plus soucieux de se partager le million d’euros du tonton (décédé quelques mois après avoir gagné au Loto) que de s’occuper du devenir de ses animaux de compagnie, la chatte du défunt a mis bas sous la terrasse de mon pied-à-terre breton. Sa portée comptait trois petits, desquels elle se désintéressa très vite. Et si elle les alimentait de temps à autre, je suppose que c’était surtout pour se libérer d’un trop-plein de lait dans ses mamelles, bien plus que pour leur garantir une croissance suffisante pour survivre. Une impression qui se confirma quand elle entreprit de déménager ses petits, encore à moitié aveugle et peu mobile, dans une ruine à côté de la maison. De ce jour, on ne revit plus les petits. Dans un réflexe anthropomorphique, il serait facile d’en déduire que cette femelle n’a pas l’instinct maternel, voilà tout. Mais il se trouve qu’au mois de septembre, la même donne à nouveau naissance à trois petits, dont elle s’occupe avec grand soin jusqu’à ce jour, les amenant ainsi à l’âge de trois mois en parfaite santé.
Peut-on dégager une morale à cette histoire ? Assurément ! Le comportement de cette chatte, tel qu’observé en deux circonstances a priori identiques, nous enseigne qu’il ne suffit pas qu’une vie soit potentiellement viable pour qu’elle corresponde à l’ordre naturel des choses. Toutes choses égales par ailleurs – comme un environnement « sécurisé » et un apport quotidien de nourriture assuré – cette femelle a fait le choix diamétralement opposé, de laisser mourir, à tout le moins, ses petits en mai, et de « couver » ceux de l’automne, alors que la saison printanière est sans doute la plus favorable au développement d’une progéniture de mammifères. Pourquoi ? Sans doute parce qu’elle a considéré que les trois premiers étaient tarés d’insuffisances ne leur permettant pas de grandir normalement et/ou de faire courir un risque de dégénérescence à la population féline dans le quartier. Est-ce trop extrapoler que d’avancer une telle explication ? A vous de juger.
Quoi qu’il en soit, et parce que ce genre de comportement est pareillement observable dans la nature de manière récurrente – ainsi dans la population de renards à Hokkaido que j’ai le grand plaisir de côtoyer au quotidien et dont je vous dirai quelques mots un jour prochain – cela signifie qu’à l’échelle d’une population, certains êtres potentiellement viables font l’objet d’un processus d’élimination afin d’assurer au groupe une certaine pérennité.
Cet enseignement rapporté à l’humanité, ne me prêtez pas une pensée que je n’ai pas. Loin de moi l’idée de dire que le savoir-faire médical ne devrait pas s’appliquer aux enfants tarés d’un handicap ou nés « naturellement non viables » avant terme. En revanche j’ose prétendre qu’il serait bon de s’interroger sur le cas des grands prématurés, non de manière subjective ou péremptoire, mais en suivant un processus rigoureux, basé sur un suivi scientifique puisque les sociétés modernes disposent du recul nécessaire pour étudier l’ensemble des cas nés à partir des années 1990/2000. La vie en couveuse pendant plusieurs mois a-t-elle des conséquences sur le développement physiologique, psychologique et émotionnel de l’individu sur le long terme ? A l’heure où certains envisagent les incubateurs à nouveau-né ou l’implantation de foetus dans le corps de femmes, mortes à l’état cérébral et artificiellement maintenues en vie, les réponses seraient loin d’être inintéressantes !
De la même façon qu’il serait judicieux de suivre le parcours de santé psycho-physiologique des enfants issus de méthodes de procréation assistée, notamment celles qui flirtent avec les tentations eugénistes.
Est-ce trop demander que de vouloir mettre praticiens et parents devant leurs responsabilités vis-à-vis de la société afin que l’on arrête de faire n’importe quoi, n’importe comment, sans jamais en mesurer les conséquences ?
Le savoir-faire scientifique a autorisé une partie de l’humanité à détenir de quoi faire exploser la planète plusieurs milliers de fois, du fait de la puissance de feu atomique. Pour autant, est-ce que, depuis l’expérimentation vengeresse du 9 août 1945, un belligérant a utilisé (jusqu’à ce jour, tout au moins) une bombe H pour s’assurer une victoire militaire ? Avoir les moyens de faire, et faire avec ces mêmes moyens sont deux choses différentes. Pourquoi le corps médical se dispense-t-il d’un principe élémentaire de précaution au seul motif que son ignorance au plan fondamental lui confère néanmoins un savoir-faire aisément duplicable ?
Que la vie soit ou non précieuse, notre absence à la définir au plan existentiel devrait nous conduire à la respecter pour ce qu’elle paraît être et non à jouer aux apprentis-sorciers avec ses constitutifs !

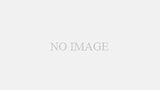

Commentaires